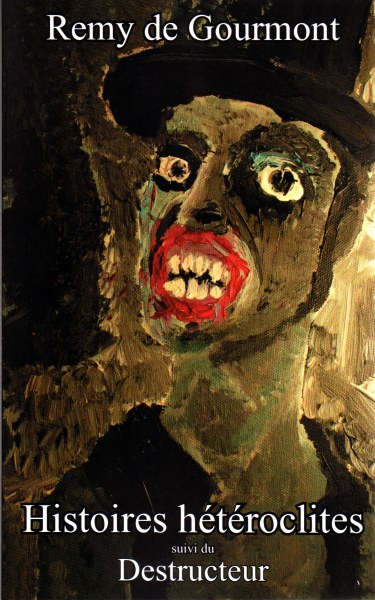Histoires hétéroclites
Les Ames d’Atala
Fabula
Les Féeries intérieures
Feuilles d’automne-1 Feuilles d’automne-2
Le Grognard-1
Le Grognard-2
![]() La Manche libre, édition de Cherbourg, 23 janvier 2010, p. 26
La Manche libre, édition de Cherbourg, 23 janvier 2010, p. 26
![]() La Presse de la Manche libre, 23 janvier 2010, p. 13
La Presse de la Manche libre, 23 janvier 2010, p. 13
![]() Céline Guénolé, « Des inédits de Gourmont réunis en un volume », La Presse de la Manche libre, 1er 2010, p. 6
Céline Guénolé, « Des inédits de Gourmont réunis en un volume », La Presse de la Manche libre, 1er 2010, p. 6

Sommaire :
AVIS AU LECTEUR, par Christian Buat
HISTOIRES HETEROCLITES
Le petit médecin
Vieux poète !
L’automate
L’alcool
Le camaldule
De l’action morale ou le dieu des propriétaires
Métaphrases : Les actes de saint Maximilien, martyr
Lettre à un marabout
La marquise
Le sang violet
Le mot qu’il ne fallait pas dire
Le polichinelle
Hélène Jégado
La deux mille et unième langue
L’homme des bois
Les bons parents
Le premier homme
Notre ancêtre
Fable
LE DESTRUCTEUR
Le bracelet
Avant l’amour
Elva
D’un pays lointain
L’âme que je cueillis
L’une ou l’autre
Le panorama de la vieille dame
REFERENCES
LES PROMENADES NARRATIVES DE REMY DE GOURMONT, par Mikaël LUGAN