En vrac [1]
Bon, vous l’aurez remarqué, le blog des âmes grince des rouages, il couine, il peine, il s’éreinte, se fatigue, se lasse, se grippe, se détraque, s’appauvrit, se traîne, se déglingue, se perturbe, se dérègle, s’ébranle et s’efflanque. Il se demande ce qu’il fout là, où il va et qui il est, s’ulcère, s’étiole, se rabougrit, fond à vue d’œil, perd appétit et appétence. Comme la solution ne vient pas, on jette en vrac histoire de repousser la funèbre échéance. Prenez ce qu’il y a à prendre tant qu’il est encore temps.
En 1953, Malaquais publie Le Gaffeur, roman où, pour la première fois, il «se marie» à un personnage central : « Je m’efforce, dans ce livre, de peindre la Barbarie, mais cette fois-ci, contrairement à ce que j’avais fait dans mes Javanais et dans ma Planète, sur le plan individuel, à travers l’existence d’un seul personnage. Le livre est écrit à la première personne. Pas de date précise, pas de lieu géographique, cela se passe dans la Cité, au sens romain du mot, qui englobe la société dans sa totalité historique. » Le Gaffeur est une sorte de conte philosophique qui dénonce la mutilation de la conscience dans une société où la Cité écrase les individus et se perpétue en interdisant toute manifestation de pensée.

Ce livre marque un tournant dans l’œuvre de Malaquais. Pour la première fois une thèse, philosophique ou politique, sous-tendait le récit. Elle n’empêcha pas la réussite romanesque, mais elle revendiquait une importance qui crut dans les écrits suivants, jusqu’à faire sortir Malaquais du domaine de la fiction.
Le Gaffeur parut en 1953, chez Corrêa; et en 1954 aux États-Unis, sous le titre The Joker. A sa sortie, l’œuvre connut un remarquable succès critique : le style de Malaquais fut souvent comparé à celui de Kafka. Les critiques élogieuses furent tout aussi abondantes aux États-Unis, et il y eut même des articles sur le roman dans des journaux hollandais et pakistanais. Pourtant les ventes ne suivirent pas… L’œuvre a été rééditée chez Phébus en 2001 et en 2016 chez L’Échappée qui décidément a de la ressource : https://www.lechappee.org/le-gaffeur
Une critique du Gaffeur, un « 1984 » français par Bernard Quiriny sur le site de l’Opinion. Quant au site consacré à l’auteur, c’est à cette adresse : http://www.malaquais.org/

Le Croquant d’Henri Calet : Le 26 juin 1955, l’émission « Soirée de Paris » proposait « Le Croquant indiscret », un reportage d’Henri Calet sur le grand monde, la vie mondaine parisienne… Henri Calet qui avait déjà réalisé des documentaires radiophoniques sur la pauvreté, était allé tendre son micro dans les beaux quartiers, dans les bals, les fêtes, les hôtels particuliers où le « bottin mondain », (particulièrement les femmes du monde), passait le plus clair de son temps. Calet, l’indigène de Montparnasse, en visite dans les arcanes et les hôtels particuliers de la capitale, interrogeant grandes-duchesses et baronnes pas tout à fait nées : on croit rêver ! Pourtant, il faut lire l’enquête du Croquant indiscret pour tout comprendre des frusques et des frasques du Tout-Paris des années cinquante. Cet ouvrage tient du document et du divertissement. Calet se promène chez les riches, le sourire en coin mais sans caricaturer ; il cambriole des yeux et des oreilles la haute société avec l’aplomb, la santé d’écriture d’un type qui achète ses costumes à tempérament et qui n’a toujours pas réglé sa note de dentiste… C’est édité dans Les Cahiers Rouges de Grasset.

Bon, et pis ça va bien cinq minutes de zieuter chez les riches. Retour au tiéquar avec La petite Gamberge de Giraud : paru aux éditions Denoël en 1961, La Petite Gamberge c’est l’histoire de Bouboule et sa bande : Le Manchot, Pierrot la Tenaille, la Douleur et Roger. Ces cinq malfrats respectés du quartier tiennent leurs assises à La Bonne Treille, un troquet en pente de la rue de la montagne Sainte-Geneviève :
Ils seront donc cinq ! Comme les jeudis de LA semaine ou les heures de la Marquise, cinq qui tiennent comme grains en grappe à leur poisseuse table de La Bonne Treille, une rade de la montagne Sainte-Geneviève, qui leur sert de rocher à moules, de quartier général et d’abreuvoir. Alors, j’énumère : lui, c’est Bouboule, le cogito de la bande, le cérébré du quintette, l’autre c’est la Tenaille, fringante jeunesse, voilà en trois la Douleur, camionneur, suit le Manchot, comme son ombre l’indique, on clôt avec Robert dit Robert. Un bel équipage qui fait honneur à l’établissement, des zigues affûtés, hauts en truandaille et madrés en diable. À l’issue d’un coup d’élite en bordure de Seine, de quoi se voir retraité, Robert se fait poisser, panique chez les messeigneurs-la-pince qui s’égaillent d’autant que Pierrot a marié une goualeuse et la Douleur joue les obligés du volant avec les gens des puces. Qui a fait quoi ? Qui doit payer ? Une histoire d’hommes, sombre à souhait, où il n’y a pas que les rues qui soient en pente. Paru chez Denoël l’année 1961, deuxième roman du Limougeaud Robert Giraud, cette Petite Gamberge vaut moins pour l’intrigue qui là sert d’espalier, que pour la flamboyante vigne vierge poétique qui se déploie dans le livre, un lierre de mots qui enserre au plus près le mystère de Paris ; avec Giraud, Paris se hume, se scrute, se savoure, se lampe à longs traits, lumières, parfums, cadences, silhouettes, tout fait brin dans cet herbier urbain proche des dérades d’un Yonnet, d’un Fargue ou d’un Calet. Alors, chaussez solide, le paysan de Paris a la foulée ample et la rêverie au long cours. Pour ceux qui ont besoin d’un guide, Olivier Bailly, impeccable préfacier, a fléché le parcours et sous-titré les plaques de rues, donc pas d’excuse !
Dans le cadre du Festival des Troquets de Paris, rencontre avec Olivier Bailly autour de Robert Giraud – samedi 19 novembre à 18h au Dilettante
A VOS AGENDAS ! A l’occasion de la parution de Troquets de Paris de Jacques Yonnet aux Editions de L’Echappée et de la réédition de La Petite Gamberge de Robert Giraud aux éditions Le Dilettante, venez rencontrer Olivier Bailly, biographe de ce dernier (Monsieur Bob, Stock, 2009) ; il évoquera ces deux auteurs, chroniqueurs de L’Auvergnat de Paris entre autres, qui ont su mettre Paris en bouteille, samedi 19 novembre, à partir de 18 h à la librairie Le Dilettante, 7 place de l’Odéon, 6e. La rencontre sera précédée d’une balade entre la Maube et la Mouffe, animée par le guide Jean-Manuel Traimond (départ 15 h place de la Contrescarpe), et suivie, à 20 h 30 au théâtre de la Vieille Grille, 9 rue Larrey, 5e, du spectacle Chansons de charme pour situations difficiles de Pierre Mac Orlan, interprétée par Laurent Berman, Jules Bourdeaux, Marc Havet, Charlotte Popon et mis en scène par Anne Quesemand. Pour ces deux manifestations hors les murs de la librairie, réservation obligatoire sur info@lechappee.org
Sinon, vous pouvez lire les critiques de l’ouvrage entre autres par Quiriny et Leroy sur le site des éditions Le Dilettante.
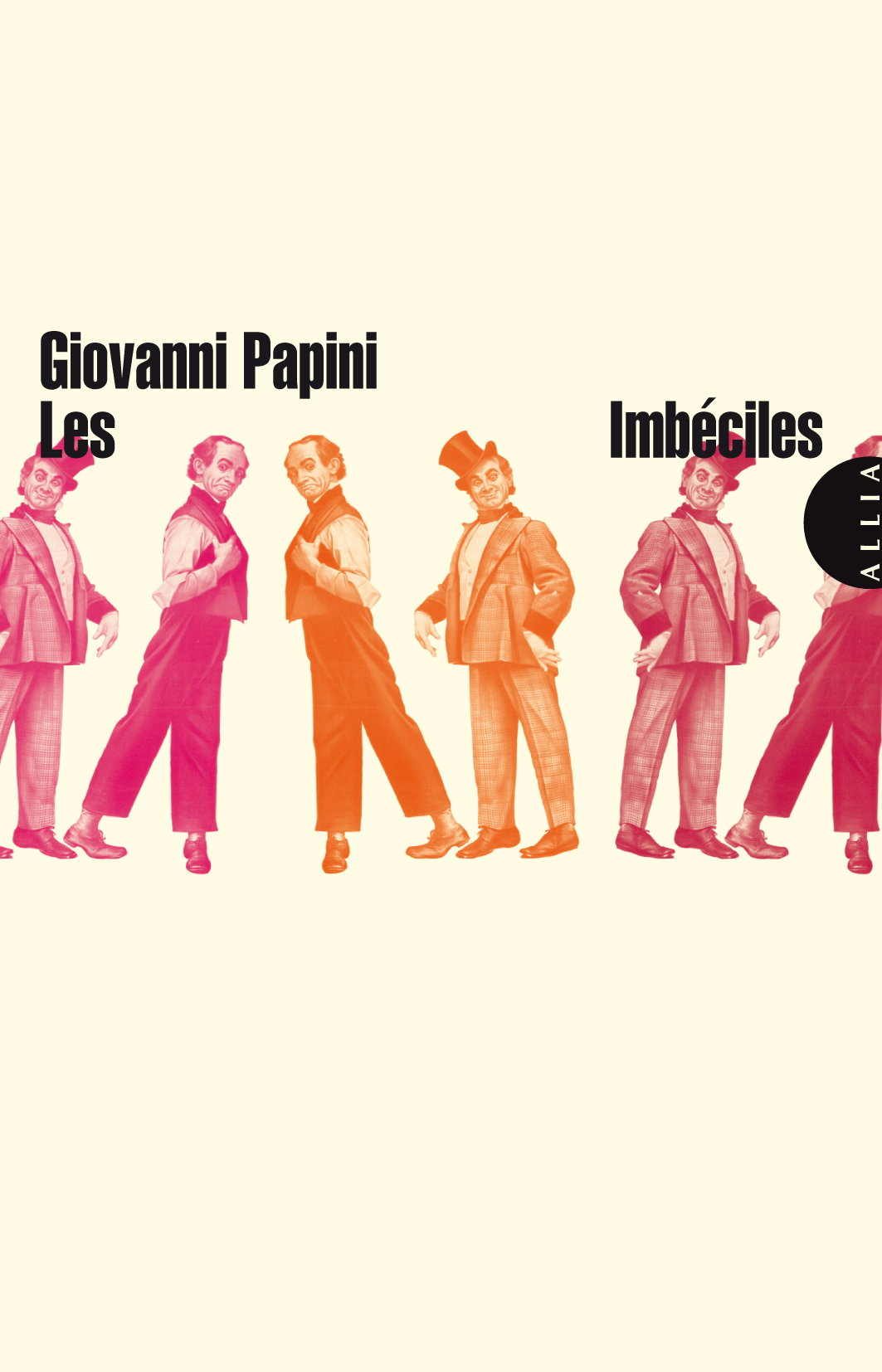
Nous le citions dans un entretien très hélvète du dernier numéro de la revue Amer. Les éditions Allia ont la bonne idée de publier ce petit texte de Papini ; nois vous recommandons quant à nous ses nouvelles fantastiques parues à l’Âge d’homme.
Les Imbéciles de Giovanni Papini :
Où trouver ce livre
Livres du même auteur

C’est assez pour aujourd’hui. Si dimanche matin, vous n’avez rien de mieux à faire, vous pouvez toujours venir finir votre nuit au théâtre Sébastopol à 10h30 pour écouter Martin Dumont e le professeur Devauchelle converser autour des questions que posent la greffe du visage et la greffe des mains dans le cadre de Citéphilo 2016. Et lundi à Cambrai, vous pourrez également assister à une conférence sur les gueules cassées : En immobilisant plusieurs années durant sur un même territoire des armées venues du monde entier, la Première Guerre Mondiale a créé un véritable « phénomène expérimental » en cristallisant autour d’un même lieu nombre de blessés dont l’atteinte nouvelle était à la mesure des nouveaux armements. La France, dont le nombre de tués a largement dépassé le million au cours de ce conflit, a comptabilisé plus de 15 000 défigurés graves, ceux qu’on appellera plus tard les « Gueules Cassées ». Il fallut au corps des soignants de l’époque, inventer de nouveaux outils, développer de nouvelles techniques pour tenter de réhabiliter ces mutilés. Un siècle plus tard, notre posture a changée. Il convient désormais non plus de faire face à une situation dramatique imposée (par le conflit, par les catastrophes naturelles…), mais d’imaginer l’impensable de nouvelles situations pathologiques. Le chercheur se nourrira certes des acquis de son expérience et de celle de ceux qui l’ont précédé.

Mais la recherche en chirurgie reconstructrice des défigurés, s’appuyant sur les progrès de la technologie, se doit de créer de nouveaux instruments, d’élaborer de nouvelles techniques, de trouver des matériaux innovants, bref de glisser petit à petit vers une chirurgie régénératrice dont on prendra en compte toutes les dimensions.
Tel est le but de l’Institut Faire Faces : concentrer en un lieu les compétences venues d’autant d’équipes de chercheurs autour de la thématique de la défiguration.
Bernard DEVAUCHELLE cumule de nombreuses activités : Professeur des Universités en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Praticien Hospitalier, Chef du Service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du CHU d’Amiens, Spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Laisser un commentaire
5/11/2016